PREAMBULE :LES DEBUTS DE LA TELEVISION
L'ère "mécanique"
ou les "Trente" glorieuses
 En visite chez le directeur
général de la BBC en 1934, le ministre français des PTT George Mandel
découvrait avec intérêt un meuble encombrant doté d'une minuscule fenêtre en
forme de loupe : un téléviseur. Lorsqu'il y vit apparaître la retransmission en
direct du Derby d'Epsom par le pionnier écossais John Logie Baird, avec une qualité d'image grossière mais néanmoins
suffisante pour y distinguer les chevaux et leurs cavaliers, le ministre fut
convaincu : la télévision était une invention de l'avenir et il fallait la
développer le plus vite possible en France.
En visite chez le directeur
général de la BBC en 1934, le ministre français des PTT George Mandel
découvrait avec intérêt un meuble encombrant doté d'une minuscule fenêtre en
forme de loupe : un téléviseur. Lorsqu'il y vit apparaître la retransmission en
direct du Derby d'Epsom par le pionnier écossais John Logie Baird, avec une qualité d'image grossière mais néanmoins
suffisante pour y distinguer les chevaux et leurs cavaliers, le ministre fut
convaincu : la télévision était une invention de l'avenir et il fallait la
développer le plus vite possible en France.
Certes,
le français René Barthélémy avait réalisé une première démonstration publique en
30 lignes le 14 avril 1931. Sur un écran de 40 cm x 30cm dans
l'amphithéâtre de l'Ecole Supérieure d'Electricité de Malakoff, il avait diffusé
le court métrage «L'Espagnole à l'Eventail» depuis la Compagnie des Compteurs de
Montrouge, distante de 2 kms
(pour voir sa secrétaire Suzanne Bridoux devant la caméra, cliquer
ici
).
Le ministre Queuille avait ensuite autorisé
l'installation d'un studio rudimentaire au 87, rue de Grenelle. Mais la
Grande-Bretagne diffusait régulièrement depuis 1932 les programmes expérimentaux
du pionnier écossais John Logie Baird dans la bande des ondes moyennes, et son
"Televisor" se répandait petit à petit chez quelques Britanniques amateurs
d'innovation technique.
De retour à
Paris, Mandel mettait en place avec René Barthélémy un studio de télévision dans
les locaux de l'Ecole Supérieure des PTT, au 103 rue de Grenelle, non loin de la
Tour Eiffel, tandis qu'au Havre Henri de France poursuivait ses essais en 60 puis en
120 lignes sur l'émetteur de Radio Normandie.
Pour plus de détails sur
l'histoire de la TV britannique des années 30, voir les très beaux sites de
MM. André
Lange et Don Mac Lean.
 A cette
époque, les émissions TV expérimentales étaient diffusées sur les stations de
radio pendant leurs interruptions de programme (les radios n'émettant pas en
continu). Au lieu des paroles et de la musique, l'auditeur entendait alors un
vrombissement bizarre : l'émission de télévision !
A cette
époque, les émissions TV expérimentales étaient diffusées sur les stations de
radio pendant leurs interruptions de programme (les radios n'émettant pas en
continu). Au lieu des paroles et de la musique, l'auditeur entendait alors un
vrombissement bizarre : l'émission de télévision !
(pour
voir Suzanne Bridoux en direct du «Poste Parisien» cliquer
ici
).
L'analyse électronique
de l'image, très rudimentaire,
était réalisée avec des moyens relevant du bricolage, à partir d'un «disque de Nipkow» parcouru
d'une spirale de trous tournant à grande vitesse devant une cellule photo-électrique.
Celle-ci, variant d'éclairage au passage de chaque trou, produisait le signal vidéo.
A la réception, la persistence rétinienne de l'oeil permettait de reconstituer
l'image avec une lampe au néon : son intensité variait derrière un disque comportant
le même nombre de trous que celui de l'émetteur. Un signal spécifique en assurait
le synchronisme.
Un disque percé de 30 trous donnait une image en 30
lignes, un autre percé
de 60 trous donnait une image de 60 lignes. L'image était
minuscule et floue. Une énorme loupe permettait d'atteindre la taille
d'une carte postale.
Les
essais de télévision étaient souvent muets, le son ne pouvant être diffusé qu'en
simultané par une autre station de radio. La définition retenue était de 60
lignes, mais très rapidement le besoin d'obtenir une image plus détaillée
poussait Barthélémy à porter l'analyse de l'image à 180 lignes. Cette définition,
pratiquement le maximum pouvant être atteint par les moyens mécaniques, était
également retenue par l'Allemagne en 1935 (pour
voir le camion de reportage allemand cliquez
ici
)
et les Etats-Unis. Quelques années
plus tard en Grande-Bretagne, dans le duel qui allait l'opposer au redoutable
concurrent "tout électronique" Marconi-EMI, Baird ira jusqu'à 240
lignes mais devra s'avouer vaincu face à l'estocade finale de son challenger
: une télévision en 405 lignes totalement électronique...
La caméra
mécanique française "à disque de Nipkow" existe toujours : elle figure en
bonne place au musée de la radio-télévision de la Maison de
Radio-France (on
la voit à droite sur la photographie ci-dessous).
En parallèle, les
recherches amenaient cette télévision gourmande en bande de fréquences, à émigrer
vers les ondes "ultra-courtes" dans la gamme des 10 mètres, d'utilisation
plus complexe que les ondes moyennes. Le studio de l'Ecole Supérieure des PTT prenait
de l'ampleur en recevant un équipement imposant : un éclairage de 45 kW pour
pallier l'insuffisante sensibilité de la caméra " mécanique" et un puissant
système de réfrigération avec quatre bouches d'aération dignes d'un paquebot !
Il fallait en effet ramener la température sur le plateau ( 60° environ! ) à un
niveau plus acceptable pour les présentateurs et les artistes... Ceux-ci
luttaient malgré tout contre les coups de soleil et les écoulements du
maquillage outrancier nécessaire à cette prise de vue encore
balbutiante (pour
voir Suzy Winker, première présentatrice de la télévision française en 1935,
cliquez
ici
).
Pour découvrir la télévision mécanique et
admirer la reconstitution d'une caméra et d'un téléviseur opérationnels en 60
lignes (voir la mire ci-dessus) , le superbe travail réalisé par M. Roger Dupouy
est présenté en détail sur son site http://perso.wanadoo.fr/roger.dupouy.
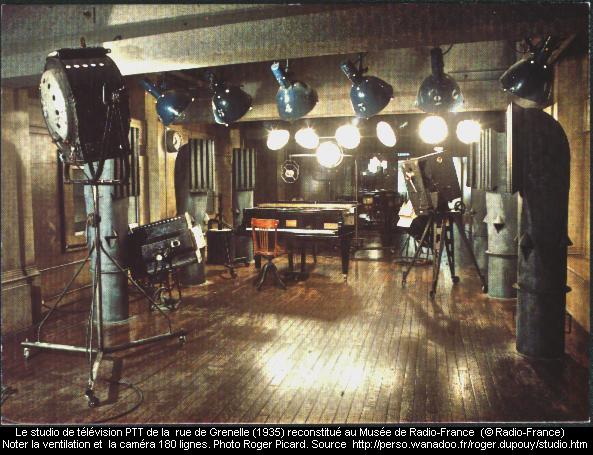
La télévision
"électronique"
«
Nous
avons fait un beau voyage... »
Le 10 novembre 1935, sur de petits écrans verdâtres
(les recherches n'avaient pas encore permis d'obtenir une image en noir et blanc) quelques spectateurs
privilégiés découvraient le visage aimable de
Mlle Béatrice Bretty, Sociétaire de la Comédie Française (et amie très proche du
ministre) qui rendait compte d'une tournée du "Français" en Italie. Encore
expérimental, le programme était capté par seulement 300 ou 400 récepteurs à
Paris ( cliquer
ici ). Peu
nombreux étaient les comédiens et artistes acceptant de participer à ces
émissions régulières, mais très sommaires et trop
confidentielles.
Le 441 lignes,
norme universelle ?
.jpg) Diffusées trois jours par
semaine (de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30) et le dimanche (de 17h30 à 19h30) les
émissions étaient composées de variétés et d'interviews
en direct auxquelles s'ajoutaient des films d'actualités
cinématographiques et de court métrage.
Heureusement l'Exposition
Universelle de 1937 allait fortement contribuer à mieux faire connaître la
télévision auprès du public, tandis que les travaux continuaient pour améliorer
ses performances techniques.
Diffusées trois jours par
semaine (de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30) et le dimanche (de 17h30 à 19h30) les
émissions étaient composées de variétés et d'interviews
en direct auxquelles s'ajoutaient des films d'actualités
cinématographiques et de court métrage.
Heureusement l'Exposition
Universelle de 1937 allait fortement contribuer à mieux faire connaître la
télévision auprès du public, tandis que les travaux continuaient pour améliorer
ses performances techniques.
Depuis 1936 en effet, la BBC
avait abandonné la télévision mécanique de Baird au profit du
système entièrement électronique de Marconi-EMI : la définition de 405
lignes allait d'ailleurs vivre des décennies de gloire au Royaume-Uni, son
abandon définitif n'intervenant qu'en... 1983.
Dès la même année, les
Allemands avaient donné le départ à un ambitieux projet de télévision en
diffusant les Jeux Olympiques de Berlin dans la capitale nazie avec une médiocre
définition de 375 lignes qu'on allait rapidement porter à celle plus acceptable
de 441 lignes.
Les américains de RCA les avaient précédé de peu sur ce
même standard, abandonnant la faible définition provisoire de 343 lignes
(également choisie par... l'URSS) qu'ils avaient initialement utilisée lors des
premières émissions diffusées de l'Empire State Building de New-York.
Les
Français suivaient le mouvement en installant un émetteur de 30 kW, le plus
puissant du monde, au pied de la Tour Eiffel. Deux énormes câbles coaxiaux
y étaient tirés jusqu'à des jeux d'antennes fixés à son sommet, assurant une
bonne réception dans un rayon de 60 à 80 kilomètres autour de la capitale. De
timides
publicités commençaient à proposer des téléviseurs (cliquer
ici et
ici
).
En
1938, la Télévision Française devenait entièrement électronique avec une
porteuse vidéo en 455 lignes et sa porteuse audio associée. La sensibilité
améliorée des caméras permettait désormais des conditions de tournage
acceptables, avec un éclairage moins colossal et surtout des prises de vues en
plan plus large.
Les programmes se développaient quelque peu. Malgré
l'impossibilité théorique de les relier entre elles, on envisageait sérieusement
l'installation de stations dans les grandes villes de province : Lyon, Marseille
et Bordeaux étaient planifiées et des essais en 455 lignes avaient lieu à Lille
au printemps de 1939. Mais la guerre allait mettre un terme à tout cela dès le
mois de septembre : les émetteurs TV de Londres et Paris cessaient leurs
émissions le jour même de la déclaration des hostilités, et personne ne savait
combien de temps durerait ce silence forcé.
Le 441 lignes en France
Pour éviter que son
matériel ne soit livré à l'Occupant, la Résistance avait décidé de saboter
l'émetteur de télévision parisien. Les Allemands, de leur côté, avaient mis en
service dès 1935 le premier véritable réseau de télévision au monde : des
câbles spéciaux de la Reichspost transmettaient les émissions en 180 lignes
du "Fernsehsender Paul Nipkow" berlinois à Hambourg, Francfort, Bayreuth
et Leipzig où des émetteurs locaux les diffusaient dans ces villes pour 4000
récepteurs familiaux et plusieurs salles de télévision publique. Ce service
allait même être maintenu (en 441 lignes) sur ce réseau de câbles malgré la
destruction de la tour TV «Funkturm» de Berlin en
1944...
Spécialistes du pillage industriel dans les pays occupés, les
nazis voulaient récupérer dès août 1941 certains éléments de l'émetteur 455
lignes français. La société Telefunken avait en effet adopté une définition
de 441 lignes toute proche et utilisée aussi, nous l'avons vu, par les Etats
Unis.
La société allemande,
qui était déjà associée à la Compagnie des Compteurs depuis 1936, signait avec
elle un nouvel accord de "collaboration" ( ! )
pour l'installation d'une station de
télévision à Paris.
En réalité, l'initiateur de ce projet était loin d'être
un fanatique de la propagande hitlérienne !...
Mandaté par Telefunken pour
démanteler l'émetteur français, le jeune officier allemand Kurt
Hinzmann, prit rapidement goût à la vie parisienne et n'eut bientôt aucune envie
de retourner à Berlin : la station locale, dont il avait dirigé les programmes
dès 1938, tombait dans la routine d'émissions pour quelques hôpitaux militaires
et dignitaires nazis privilégiés.
Habile, Kurt Hinzmann sut convaincre les interlocuteurs appropriés et
pour installer sa nouvelle station, exigeait de rechercher et choisir lui-même
les futurs studios aux frais de l'Etat Français. Son choix définitif se portait
sur les vastes locaux de l'ancien théâtre-dancing «Magic City» au 188 rue de
l'Université, sur la «Pension de famille de l'Alma» au 13-15 rue Cognacq Jay et
sur un garage qui les séparait. Autre atout, ces futurs studios avaient
l'avantage de la proximité de la Tour Eiffel, résolvant ainsi les problèmes de
liaisons avec l'émetteur : les câbles coaxiaux ne pouvaient en effet dépasser
quelques centaines de mètres sans déperdition de la qualité d'image à cette
époque.
Hinzmann était un visionnaire : abandonnés seulement dans les années 80
par les deux grandes chaînes françaises TF1 puis Antenne 2, ces locaux hébergent
désormais TV5, la chaîne internationale francophone.
L'apogée : les années de guerre
Inaugurée le 30 septembre 1943, «Paris-Télévision» alias
«Fernsehsender Paris» commençait à émettre depuis la Tour Eiffel avec la
nouvelle définition de 441 lignes, sur le modèle allemand et avec du matériel
Telefunken.
Les deux à quatre heures d'émissions quotidiennes étaient bilingues
(français-allemand), la station ayant pour mission prioritaire la distraction
des blessés militaires allemands hébergés dans les hôpitaux de la région
parisienne.
Théâtre, films et variétés dominaient une programmation établie de façon
à être comprise par le plus grand nombre : alors que la danse et la chanson
n'avaient pas besoin de traduction, certaines émissions faisaient l'objet de
diffusions séparées en français et en allemand, notamment pour le théâtre et les
actualités cinématographiques de propagande allemande "Wochenschau" et
"France-Actualités" de Vichy.
A son insu, l'Occupant allait d'ailleurs renseigner
très
efficacement les Alliés sur l'efficacité de leurs bombardements sur Paris :
découvert par hasard, le puissant signal de la Tour Eiffel put être capté grâce
à un "rideau" de 32 ( ! ) antennes de réception et un téléviseur 405
lignes britannique adapté aux 441 lignes et aux
fréquences parisiennes. Regardés avec attention par des agents secrets à la
station radar de Beacon Hill, dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, les journaux
français et allemands du "Fernsehsender Paris" permirent ainsi aux Britanniques
de
connaître pendant deux
ans l'efficacité réelle de leurs raids
aériens !...
De son côté d'ailleurs, l'émetteur 405 lignes d'Alexandra
Palace reprit du service de façon inattendue : ses fréquences étant proches de
celles d'une balise de radioguidage de la Luftwaffe installée à Calais, il fut
adapté pour en brouiller les émissions destinées à orienter les bombardiers
nazis vers Londres. Ceux-ci, égarés dans l'Atlantique, ne purent utiliser ce
système qui fut rapidement abandonné...
A Paris, la nouvelle station de télévision employait plus de 100
personnes. Elle fonctionnait de midi à minuit, mais se contentait de relayer la
radio «HöNäFü» de Berlin en accompagnement sonore de sa mire en dehors des émissions
télévisées. Deux caméras Téléfunken étaient en service et hormis les films de
télécinéma, toutes les émissions se faisaient en direct, aucun moyen
d'enregistrement n'existant à cette époque.
Le fils de René Barthélémy révéla plus tard que son père, hostile à cette
collaboration forcée avec les Allemands, rélégua son précieux téléviseur dans sa
cave jusqu'à la Libération. Pourtant Kurt Hinzmann était loin d'être un
propagandiste nazi. Ses équipes techniques étaient placées sous la tutelle
officielle du «HöNäFü», sous contrôle de l'omniprésente Gestapo, mais
accueillaient en réalité avec l'indifférence bienveillante de Hinzmann,
des jeunes réfractaires au STO, des juifs ou des communistes recherchés par
les Nazis. Lorsque la Gestapo se présentait pour un contrôle, il faisait
discrètement prévenir ses collaborateurs en danger pour les mettre à l'abri.
Hinzmann ne s'en tiendra d'ailleurs pas là : le 17 août 1944, recevant l'ordre
de Berlin de faire sauter les installations, il se contentera de faire tirer
quelques coups de feu symboliques dans des équipements sans importance, en
laissant aux Français une station de télévision totalement opérationnelle
et parmi les plus performantes du monde.
Malgré les rigueurs de l'immédiate après-guerre, et alors que le réseau
de radiodiffusion était exsangue (seul l'émetteur de Limoges avait échappé au
sabotage) la télévision parisienne était en mesure de reprendre ses émissions
dès le 1er octobre 1945. Celles-ci allaient se limiter à une heure par jour pendant
plusieurs mois, mais l'essentiel étaient là : avec ses 441 lignes et ses
équipements récents hérités de la guerre, la télévision française était devenue
une réalité (pour
voir une émission de plateau avec caméra 441 lignes cliquer
ici,
pour voir un message d'excuse d'interruption du son, cliquer
ici
).
Le déclin : la course aux définitions
Le gouvernement français avait su très vite reconnaître la valeur de Kurt
Hinzmann, qu'il avait fait rappeler dès 1948 pour aider la Compagnie des
Compteurs à imposer sa technologie en 450 lignes dans la lutte des définitions
dans l'Allemagne en reconstruction. Sous la forte influence américaine (plan
Marshall oblige) ce pays choisira finalement le 625 lignes,
adaptation "européenne" du 525 lignes américain définitivement adopté dès 1941
aux dépens du 441 lignes. Excellents technico-commerciaux, les Allemands imposeront rapidement leur
nouveau standard dans toute
l'Europe, puis, progressivement dans tous les pays du monde s'équipant en réseaux
de télévision.
Deux pays résisteront longtemps à cette vague
venue d'Allemagne : ses anciens ennemis dont les émetteurs avaient dû se
taire dès le 3 septembre 1939. La France adoptera le 819 lignes de 1948
à 1983 et la
Grande-Bretagne conservera son 405 lignes jusqu'à cette même date (pour
voir la pose d'une antenne TV captant la BBC dans les années 50, cliquez ici
). Avec quelques variantes techniques
individuelles, la BBC et l'ORTF n'adopteront le 625 lignes que dans
les années 60 pour leur deuxième programme, lorsqu'une conférence internationale
imposera cette définition unique pour les futures émissions en couleurs.
Dès la Libération, l'émetteur 441 lignes parisien fonctionnera à la satisfaction générale de
ses téléspectateurs pendant plusieurs années, même après le lancement du réseau national 819 lignes, qui aura la préférence des professionnels et du
public grâce à ses images d'une qualité inégalée (pour
voir le sommet de la Tour Eiffel vers 1950, cliquer
ici
). Entre temps, faisant preuve d'ingéniosité
et de persévérance, techniciens, réalisateurs et journalistes auront su lancer
la « RTF » du 441 lignes sur les chemins de la gloire : retransmission
en direct, grâce à un "ballon saucisse" militaire, de l'arrivée
du Tour de France, création du premier journal télévisé quotidien connu au
monde, diffusions de pièces de théâtre (dites "dramatiques")
en direct... La découverte du «convertisseur de définition» (une caméra 441 lignes
reprenant l'image d'un moniteur 819 lignes à tube cathodique spécial) sonnera le
glas du matériel de production 441 lignes dès juillet 1952 (
pour voir l'image de la speakerine Catherine Langeais convertie de 819 en 405
lignes sur le réseau de la BBC, cliquer
ici
). L'émetteur
lui-même, initialement prévu pour durer jusqu'en 1958, cessera brutalement de
fonctionner le 2 janvier 1956, victime d'un incendie après une longue nuit
consacrée à la couverture des élections législatives.
Dans les années 80 la revue Antennes de TDF a révélé qu'en
reconnaissance pour les services rendus par Kurt Hinzmann, la France lui a
octroyé une pension d'ancien fonctionnaire de la Radiodiffusion-Télévision
Française. (à
suivre)
LE PLUS...
Pour ceux qui détiennent l'excellent livre "Cognacq Jay 1940 - La télévision française sous l'occupation" consacré au Fernsehsender Paris
par Thierry Kubler et Emmanuel Lemieux, la page 63 manquante est disponible ici (un grand merci à Monsieur Kubler).
 En visite chez le directeur
général de la BBC en 1934, le ministre français des PTT George Mandel
découvrait avec intérêt un meuble encombrant doté d'une minuscule fenêtre en
forme de loupe : un téléviseur. Lorsqu'il y vit apparaître la retransmission en
direct du Derby d'Epsom par le pionnier écossais John Logie Baird, avec une qualité d'image grossière mais néanmoins
suffisante pour y distinguer les chevaux et leurs cavaliers, le ministre fut
convaincu : la télévision était une invention de l'avenir et il fallait la
développer le plus vite possible en France.
En visite chez le directeur
général de la BBC en 1934, le ministre français des PTT George Mandel
découvrait avec intérêt un meuble encombrant doté d'une minuscule fenêtre en
forme de loupe : un téléviseur. Lorsqu'il y vit apparaître la retransmission en
direct du Derby d'Epsom par le pionnier écossais John Logie Baird, avec une qualité d'image grossière mais néanmoins
suffisante pour y distinguer les chevaux et leurs cavaliers, le ministre fut
convaincu : la télévision était une invention de l'avenir et il fallait la
développer le plus vite possible en France. A cette
époque, les émissions TV expérimentales étaient diffusées sur les stations de
radio pendant leurs interruptions de programme (les radios n'émettant pas en
continu). Au lieu des paroles et de la musique, l'auditeur entendait alors un
vrombissement bizarre : l'émission de télévision !
A cette
époque, les émissions TV expérimentales étaient diffusées sur les stations de
radio pendant leurs interruptions de programme (les radios n'émettant pas en
continu). Au lieu des paroles et de la musique, l'auditeur entendait alors un
vrombissement bizarre : l'émission de télévision !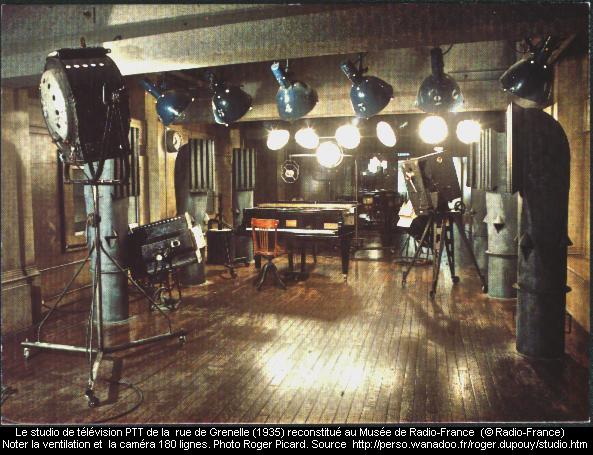
.jpg) Diffusées trois jours par
semaine (de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30) et le dimanche (de 17h30 à 19h30) les
émissions étaient composées de variétés et d'interviews
en direct auxquelles s'ajoutaient des films d'actualités
cinématographiques et de court métrage.
Heureusement l'Exposition
Universelle de 1937 allait fortement contribuer à mieux faire connaître la
télévision auprès du public, tandis que les travaux continuaient pour améliorer
ses performances techniques.
Diffusées trois jours par
semaine (de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30) et le dimanche (de 17h30 à 19h30) les
émissions étaient composées de variétés et d'interviews
en direct auxquelles s'ajoutaient des films d'actualités
cinématographiques et de court métrage.
Heureusement l'Exposition
Universelle de 1937 allait fortement contribuer à mieux faire connaître la
télévision auprès du public, tandis que les travaux continuaient pour améliorer
ses performances techniques.